Apparu au XVIIe siècle aux Antilles, la canne a sucre est cultivée un peu partout en Martinique et en Guadeloupe. Véritable pilier économique, de nombreux hectares sont consacrés à la culture de cet or roux. La canne a sucre est destinée à deux types d’industrie : le sucre et le rhum. Dans cet article, nous nous pencherons sur l’industrie du sucre aux Antilles et ses conséquences sur la population antillaise.
-
Le sucre en Guadeloupe

Le sucre fait son apparition en 1640. L’arrivée des Juifs et de leurs techniques de fabrication et de raffinement, en 1654, permet à la Guadeloupe de s’auto-suffire. Denrée extrêmement rare réservée à l’élite française, la Guadeloupe devient une véritable puissance car elle alimente la France en sucre. Les colons y voient une opportunité et décident d’abandonner les autres cultures, comme celle de l’indigo, pour se concentrer sur la culture de la canne. Ce nouveau business favorise l’essor de l’esclavage à cause du besoin de main-d’œuvre pour récolter et transformer les cannes.
Suite à l’abolition de l’esclavage (1848), les moulins de pierre laissent la place aux usines. La mise en place d’un système salarial et la création de la Banque de Guadeloupe (1851) permettent aux propriétaires d’améliorer leurs entreprises et payer leurs salariés.
Malheureusement, le développement du sucre de betterave apparu en 1830, provoque une surproduction et la chute du prix du sucre. Les usines se doivent de concentrer les cultures et de nombreuses affaires familiales ferment leurs portes.
Depuis une trentaine d’années, les sucreries mettent la clé sur la porte. Même si la filière canne/sucre reste vitale pour l’économie du pays, la concurrence est rude. Ces entreprises fonctionnent encore grâce aux subventions de l’État et de l’Union Européenne.
Selon nous, si la Guadeloupe ne souhaite pas voir son économie chuter, il faut qu’elle développe ses cultures. Malgré la nouvelle convention canne 2016-2022 signée en janvier 2016, visant à garantir la pérennité de la filière, l’île ne peut plus se baser que sur la canne à sucre… Et cela quelques producteurs l’ont compris en produisant de la banane, du chocolat et de la vanille.
*** Quelques chiffres :
- Depuis 2006, il y a 4 054 planteurs de canne à sucre en Guadeloupe. La filière canne/sucre/rhum représente 9 000 emplois en moyenne et fait vivre 30 000 habitants.
- En 2015, il y a une chute de 30% des replantations, malgré les aides.
- En 2016, La canne a sucre est cultivée sur 14 000 hectares. Dans les années 80, la superficie était deux fois plus importante.
- En 2016, 493 800 tonnes de cannes ont été récoltées contre 656 566 tonnes en 2015. C’est une perte de 24% due à une forte sécheresse en 2015.
-
Le sucre en Martinique
Apparu en 1650, c’est en 1696 avec la fondation de l’habitation Saint-Jacques par le père Labat, que le sucre commence à être fabriqué. Tout comme en Guadeloupe, la Martinique a besoin de main-d’œuvre pour développer sa production… C’est ainsi que l’esclavage et son commerce triangulaire se forme. L’afflux d’une nouvelle population africaine sur la terre martiniquaise pousse les amérindiens (nommés Les Caraïbes) à s’exiler vers la côte atlantique avant d’être totalement chassés par les colons.
Avec l’abolition de l’esclavage, en 1848, la majorité des sucreries ferment leurs portes. L’une des habitations s’en sort, il s’agit du Galion,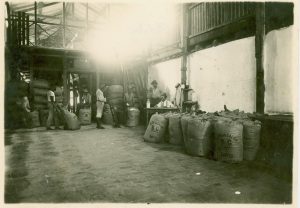 elle devient une usine en 1861. Celle-ci connaît la crise avec la surproduction du sucre (le sucre de betterave fait concurrence) et les prix chutent. L’usine survivra à cette crise en diminuant les coûts de production de la canne et en apportant des modifications foncières qui impacteront les salariés. C’est le début des conflits sociaux et des grèves… La crise durera jusqu’en 1905.
elle devient une usine en 1861. Celle-ci connaît la crise avec la surproduction du sucre (le sucre de betterave fait concurrence) et les prix chutent. L’usine survivra à cette crise en diminuant les coûts de production de la canne et en apportant des modifications foncières qui impacteront les salariés. C’est le début des conflits sociaux et des grèves… La crise durera jusqu’en 1905.
Aujourd’hui et depuis 1982, l’usine du Galion est la dernière usine en activité, parmi les treize que possédait la Martinique en 1960.
*** Quelques chiffres :
- Il y a 201 planteurs de canne à sucre sur une surface de 3 891 hectares, en 2016.
- La filière canne/sucre/rhum représente 3 900 emplois.
- Le Galion a produit 4 046 tonnes de sucre en 2010.
- 202 228 tonnes de canne à sucre sont récoltées en 2010, 34,8% des récoltes sont destinées à la production de sucre.
-
Les conséquences du sucre en Guadeloupe et en Martinique
En plus d’être l’un des facteurs de l’obésité, le sucre est également celui du diabète. Aux Antilles, ces maladies se répendent comme la peste !
Aujourd’hui, La Guadeloupe et la Martinique mènent une véritable bataille du sucre. La faute à qui ? Aux industriels ? Aux mauvaises habitudes alimentaires de la population ?
 Selon une étude effectuée par l’ARS, la teneur en sucre est plus élevée dans les sodas, yaourts et friandises. Comptez 50,77% de sucre en plus, dans un yaourt vendu aux Antilles. Cela est un exemple parmi tant d’autres, mais de nombreux produits laitiers et autres boissons gazeuses sont 50% plus sucrés aux Antilles qu’en Métropole. Pourquoi ?
Selon une étude effectuée par l’ARS, la teneur en sucre est plus élevée dans les sodas, yaourts et friandises. Comptez 50,77% de sucre en plus, dans un yaourt vendu aux Antilles. Cela est un exemple parmi tant d’autres, mais de nombreux produits laitiers et autres boissons gazeuses sont 50% plus sucrés aux Antilles qu’en Métropole. Pourquoi ?
Le ministère de la santé explique que le taux élevé de sucre dans les produits laitiers est dû à une inexistence de filière laitière, aux Antilles. Les entreprises n’ont pas d’autres choix que d’utiliser du lait reconstitué à base de lait en poudre, contenant plus de sucre. De plus, avant l’arrêté gouvernemental du 9 mai 2016 (il vise à garantir la qualité nutritionnel et l’entrée en vigueur de l’article 2 de la loi santé, interdisant le taux de sucre excessif dans les produits vendus en Outre-mer), il n’existait aucune loi réglementant le taux de sucre. Les entreprises se basaient sur des licences locales et des tests d’acceptabilité effectués sur le consommateur. Ainsi, les géants de l’agroalimentaire expliquaient leurs actes en affirmant que les habitants aimaient manger très sucré et qu’ils étaient difficiles de leur proposer des produits à faible quantité de sucre, sous peine qu’ils en achèteraient moins. Une affirmation réfutée par Hélène Vainqueur-Christophe qui affirme que les domiens ont été conditionnés à ce mode de consommation et qu’il faudrait les habituer à mieux s’alimenter.
Aujourd’hui où nous en sommes ?
Les choses n’ont pas évoluées… Serge Larcher (parlementaire martiniquais) dénonce le manque de régularité voir l’inexistence des contrôles. La loi n’est pas respectée, mais cela ne dérange personne. Un problème quand l’on sait que les maladies telles que le diabète et l’obésité touchent de plus en plus d’habitants !
*** quelques chiffres :
- Il y a deux fois plus de diabétiques en Guadeloupe et en Martinique qu’en France.
- 24 000 diabétiques déclarés en 2016, en Martinique. Les professionnels de santé pensent que ce chiffre ne reflète pas la réalité, car de nombreux malades ignorent qu’ils le sont… La maladie est encore très méconnue du grand public.
- En 2013, 32 746 guadeloupéens suivaient un traitement pour soigner leur diabète.
- Six diabétiques sur dix en Guadeloupe sont des femmes. En Martinique, les femmes sont, 2 à 3% en plus que les hommes, atteintes du diabètes.
- Des individus de plus en plus jeunes développent un diabète de type 2, alors que ce type de diabète devrait être observé chez les personnes âgées de 40 ans et plus.
- 129 personnes, en moyenne, sont mortes du diabète entre 2008 et 2012 en Guadeloupe.
Conclusion
Que faire pour éviter la maladie ?
 Modifiez vos habitudes alimentaires ! Évitez de manger trop gras et trop sucré, favorisez les fruits et l’eau. Sachez que vous ne devez consommer que l’équivalant de six carreaux de sucre par jour.
Modifiez vos habitudes alimentaires ! Évitez de manger trop gras et trop sucré, favorisez les fruits et l’eau. Sachez que vous ne devez consommer que l’équivalant de six carreaux de sucre par jour.
N’hésitez pas à faire de la prévention autour de vous et à vous renseigner. L’obésité favorise le diabète, mais les deux maladies peuvent être mortelles. Ne risquez pas votre vie à cause d’une surconsommation de sucre et de graisse.
Pour vous aider, nous vous invitons à visiter les sites : mangerbouger.fr et la Fédération Française des Diabétiques. Vous pouvez également vous rapprocher des structures locales comme l’AFD 972 (L’Association Française des Diabétiques de Martinique) et l’AFD 971 (L’Association Française des Diabétiques de Guadeloupe).


Commentaires récents